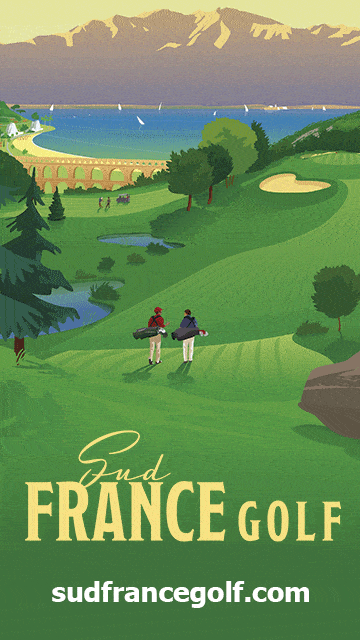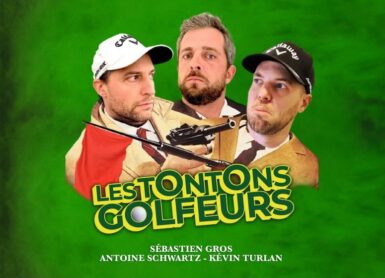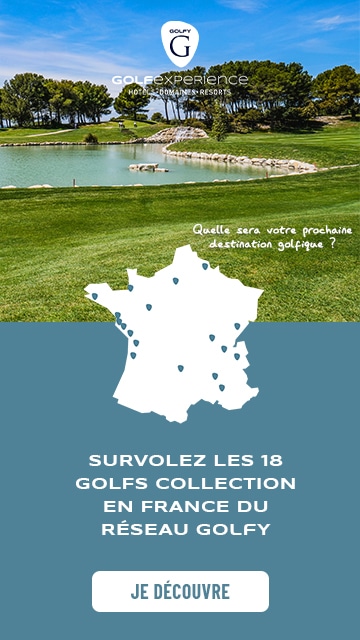Un Open à Pebble Beach offre toujours aux âmes vagabondes un joli morceau d’Amérique.
Sous l’œil malicieux de cette espèce paresseuse d’otaries qu’on appelle lions de mer, défilent ces lions de terre qui suent sang et eau pour s’arracher aux dents du rivage ou aux pièges du parcours. Non loin de là, on vient toujours en pèlerinage à Salinas, visiter la maison natale de John Steinbeck. Les héros de notre Prix Nobel n’éclusent pourtant pas les cocktails dans les club-houses, ils n’habitent pas les maisons de poupée de Carmel, aux portes de Monterey. Ce sont plutôt les clodos sublimes et désopilants de « Tortilla Flat » ou de « Rue de la sardine ». Et toute la misère des hommes ne passe-t-elle pas dans « Les raisins de la colère » ?
On peut justement dire que les concurrents du 119 ème US Open en ont avalé quelques grappes, à commencer par le plus opulent d’entre eux, Tiger Woods. Ses thuriféraires habituels en seront pour leurs frais. Pourtant, nous ne l’aurons jamais trouvé aussi humain, aussi méritant que cette fois pour s’accrocher aux branches d’une 21 ème place finale. Dominant dignement sa colère, on ne le vit jamais traîner l’accablement d’un Phil Mickelson, autre chéri de ces lieux.
Cérémonial coutumier
Disons-le, durant trois tours cet Open ne sortit guère du cérémonial coutumier.
Au ras du Pacifique, les uns et les autres bossèrent, trimèrent à qui mieux mieux pour se garder une chance d’aller au bout, ici interpellés avec la même familiarité que, chez nous, les coureurs du Tour dans le Tourmalet. Jusqu’à notre Clément Sordet, saisissant une chance ultime de passer le cut, par une manière qu’on n’emprunterait pas ailleurs de jouer le par 5 du 18 de Peeble Beach : fer 5, fer 4, approche et put, birdie ! Jusqu’à Graeme McDowell, l’ami irlandais vainqueur en 2010, retrouvant ici une nouvelle fraîcheur.
Et jusqu’à cet épatant amateur norvégien, Viktor Hovland, qui terminera à la 12 ème place, cela au prix d’un 67 fumant et à la veille de passer chez les pros, où sa gaîté au combat, autant que la violence de son swing, devraient vite imposer le personnage.
Trois tours de galère, donc, et enfin la grande explication d’un dimanche de « majeur », avec le visage tout neuf, à 35 ans, de son pur vainqueur : Gary Woodland, natif du Kansas, qui vous traverse la balle à la vitesse du son en usant comme jadis de manches en acier. Rappelez-vous, il s’était déjà signalé en ramenant le meilleur score lors du dimanche assassin du championnat de l’USPGA. Cette fois, il s’était porté en tête par un deuxième tour de Peeble Beach en 65, puis un troisième en 69, assez pour prendre un coup d’avance sur Justin Rose et à son inlassable routine, inscrite d’office au leaderboard, sans aucune trace d’exubérance, seulement l’ombre d’une inquiétude.
Quatre ou cinq vainqueurs possibles
Au départ de ce beau dimanche, il restait quatre vainqueurs possibles, dans l’ordre : Woodland, Rose, Koepka, Oostuizen, et peut-être cinq avec Rory McIlroy, que l’on sentait de nouveau capable d’une charge mémorable, de celles qui l’ont fait, comme Jordan Spieth, vainqueur de son premier majeur à l’âge du biberon. On pouvait raisonnablement parier sur Brooks Koepka, n° 1 mondial en exercice et double tenant du titre, plus que tout autre capable de reprendre quatre coups de retard sur Woodland. Le fait est que son entrée en scène fut saisissante. Jouant dans l’avant-dernière partie, dix minutes devant Woodland et Rose, il sembla marcher sur le Pacifique. En trois trous seulement, au prix de deux birdies et d’un stupéfiant recovery, il avait annoncé la couleur, bondi à la deuxième place, à deux coups de la tête. Il avait fait monter très haut la fièvre à Peeble Beach. Son compagnon de jeu, Oostuizen, était dans le bon wagon. Oostuizen et son swing modèle, c’est un peu le Molinari sud-africain, sauf si Molinari était l’Oostuizen italien. Une victoire en majeur n’a jamais rien changé au discret comportement de l’un comme de l’autre. Dommage seulement que Mc Ilroy, sonné par un double bogey au 2, ait été sorti par malchance d’une fête dont il était digne. A lui de se venger le mois prochain à l’open de Portrush. Le golf européen n’en espère pas moins car, cette année, l’Amérique est restée trop patronne chez elle, quand bien même un Dustin Johnson fût-il, une fois de plus, trahi par son putting, ou bien Speith rapidement porté disparu.
La fermeté de Woodland
Oui, après la victoire du Tigre au Masters et celle de Koepka à l’USPGA, l’affaire à l’US Open est restée trop américaine pour ne pas appeler, en Irlande du Nord, à quelque changement de bord de mer ! En rentrant un nouveau birdie au 11, Koepka à Peeble Beach n’était plus qu’à un coup de Woodland. A l’évidence, ils restaient seuls en piste. Gary, Brooks et divers autres, tel se présentait le tableau. Rose piétinait, Oostuizen allait exploser en vol. Dans le rôle de poursuivant, Koepka renouvelait au mieux le genre de poursuivi qu’il tenait le mois dernier à New-York.

Il fallait un miracle sur le par 5 final, à la verticale du Pacifique, au moins un eagle pour Koepka aux fins de combler ses deux coups de retard. Il en était capable, ce champion de l’année, beau second dans le pire des cas, puisqu’il attrapa bel et bien le green en deux. Mais, derrière, il lâcha trois putts, là où Gary Woodland, au contraire, n’en prendra qu’un, pour le birdie d’un triomphe achevé, quoique non annoncé. Mais si surprise il devait y avoir, ce serait plutôt celle d’un triomphe sans lendemain.
Denis LALANNE